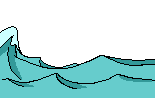
|
2.1 |
principes generaux
|
|
|||
2.1.1 |
PP de gestion, de préservation et de répartition des eaux |
|
|||
|
|
|||||
|
|
L211-1CE |
PP de gestion équilibrée de la ressource en eau |
w Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. w Protection contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines. w Développement et protection de la ressource en eau. w Valorisation de l’eau comme ressource économique & répartition de cette ressource visant à concilier les différentes activités humaines avec la santé et la conservation et le libre écoulement des eaux. |
||
|
|
L211-2CE |
PP et organisation de la préservation de la qualité et de répartition des eaux |
Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales déterminées par décret fixent notamment : § Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ( [ Décret no 91-1283 du 19 décembre 1991relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ] renvoyant à l’ [ arrêté du 26 décembre 1991]; § Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; [Décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux] § Les conditions dans lesquels peuvent être ; - Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; Pour les effluents agricoles : [ D.27 août 1993relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole] ; [D.12juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles] ; [ D.10janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole] Pour les effluents urbains : [ D 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des collectivités territoriales] voir infra item 2.4 Pour l’épandage : [ D.12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles] [ D.8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ] ; Pour les huiles et lubrifiants : [ D.8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer ] ; [ D.24 décembre 1987 relatif au déversement des détergents dans les eaux superficielles… ] - Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; cf infra … |
||
|
|
L211-3CE |
Limitation ou suspension provisoire des usages de l’eau |
Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie [ D.24 septembre 1992] |
||
2.1.2 |
Planification de la gestion et de la qualité de l’eau
|
|
|||
|
|
L212-1CE et L212-2CE |
SDAGE |
w 1 ou des SDAGE fixe(nt) pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les SDAGE définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Décisions devant être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ( non exhaustif) : - les autorisations et les prescriptions complémentaires faisant suite à une autorisation ou déclaration, relatives aux installations, ouvrages et travaux définis par la nomenclature du décret 93-743 du 29 mars 1993 . Sont ainsi notamment concernés, dans la mesure où ils ont un effet sur l’eau : les travaux connexes au remembrement, les travaux portuaires, les eaux minérales, les stockages souterrains d’hydrocarbures ainsi que l’énergie hydraulique, les effluents radioactifs, l’eau potable, - les installations classées (dont les carrières et gravières ainsi que certains dragages et affouillements dont les matériaux sont réutilisés), - les prescriptions fixées par le décret n° 92-1040 du 24 septembre 1992, relatives aux mesures de limitation ou de suspension des usages en cas de sécheresse, accidents, inondations, - la décision d’affectation temporaire de débits artificiels à certains usages (cf. article 15 de la loi du 3 janvier 1992), - les prescriptions techniques, éditées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation, - les travaux des collectivités territoriales, de leurs groupements, des syndicats mixtes, entrepris au titre de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992, tels qu’aménagement et entretien de cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, défense contre les inondations, dépollution, protection des eaux souterraines, protection et restauration des sites, écosystèmes et zones humides, - les décisions d’aménagement, entretien et exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux transférés aux collectivités territoriales et syndicats mixtes (cf. article 33 de la loi du 3 janvier 1992), - les actes des collectivités territoriales définissant les zones d’assainissement collectif, les zones relevant de l’assainissement non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, les zones où il est nécessaire de prévoir des installations spécifiques pour les eaux pluviales (cf. article 35 de la loi du 3 janvier 1992), - les règlements d’eau des ouvrages futurs ou existants en cas de révision, - les actes de gestion du domaine public fluvial, - ainsi que les programmes des collectivités publiques, et notamment les programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau. [SDAGE Adour Garonne format ZIP] [SDAGE Adour Garonne] |
||
|
|
L212-3CE à L212-6CE |
SAGE |
w Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides. Il dresse un constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique Les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le schéma, c'est-à-dire que le SAGE ne doit pas les interdire. Les décisions dont il s'agit sont énumérées dans la [circulaire du 15 octobre 1992]. Les objectifs généraux des SAGE devront être compatibles avec les orientations des SDAGE ou rendus compatibles pour les SAGE approuvés avant le 4 janvier 1997 (Circ. 12 mai 1995). La notion de compatibilité suppose que le SAGE n'interdise pas la décision administrative. [ SAGE Diagnostique zip ] [ SAGE Diagnostique ] [ SAGE Orientations de gestion zip ] [ SAGE Orientations de gestion ] [ SAGE Tendance et scénarios zip ] [ SAGE Tendance et scénarios ]
|
||
2.1.3 |
Document d’urbanisme, distribution de l’eau et assainissement |
Voir principalement Item 4.1.1 et 4.1.2 et Art R111-8 à R111-11CUrb |
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
2.2 |
Régime d’autorisation ou de déclaration AU TITRE DES LA LOI SUR L’EAU
|
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau |
|||
|
|
|||||
2.2.1 |
Principe d’autorisation ou de déclaration |
|
|||
|
|
L214-1CE et L214-3CE |
Installations concernées |
L214-1CE : les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques (cf infra) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. L214-3CE : Autorisation : les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Déclaration : les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. |
||
|
|
L214-2CE |
Renvoi à une nomenclature |
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature ( voir item 2.2.3) , établie le décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. ( Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ) |
||
|
|
// et Art 3 du décret du 29 mars 1993 |
Critère d’usage domestique |
IL est fixé par décret le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un usage domestique, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.(Art 3 du décret du 29 mars 1993) |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
2.2.2 |
Procédure d’autorisation ou de déclaration |
|
|||
|
|
L214-4CE |
Principes généraux guidant la procédure d’autorisation ou de déclaration |
L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable. (Cf Décret n°93-743 du 29 mars 1993) |
||
|
|
Déroulement de la procédure (précisions préliminaires) |
Certaines opérations ne sont pas soumise à cette procédure : Il s’agit des opérations soumises aux textes suivants : - décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. - décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible - décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base - décret no 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés |
|||
|
|
Dispositions communes relatives à la procédure d’autorisation et de déclaration |
||||
|
|
Dispositions relatives à la procédure d’autorisation |
|
|||
|
|
Dispositions relatives à la procédure de déclaration |
|
|||
|
|
L214-4CE |
Retrait ou modification de l’autorisation |
L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : - Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; - Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; - En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; - Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
2.2.3 |
Nomenclature au titre de la loi sur l’eau
|
Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. |
|||
|
|
Art 2 |
Classement en cas d’installation à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée de certains points de prélèvement d’eau |
w Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexé au présent décret, relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public. |
||
|
|
Ø Milieux aquatiques en général |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
4.1.0 |
Assèchement…. de zones humides |
§ Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : |
||
|
Supérieure ou égale à 1 ha |
A |
||||
|
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha |
D |
||||
|
|
4.2.0 |
Réalisation de réseaux de drainage |
§ Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : |
||
|
Supérieure ou égale à 100 ha |
A |
||||
|
Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha |
D |
||||
|
|
4.3.0 |
Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement d'eau dans certaines zone |
§ A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2o de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils : |
||
|
Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h |
A |
||||
|
Dans les autres cas |
D |
||||
|
|
Ø Nappes d’eau souterraines |
|
|||
|
|
1.1.0 |
Prélèvement |
§ Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu’une nappe d’accompagnement d’un cours d’eau, d’un débit total : |
||
|
à 80³ m3/h |
A |
||||
|
> à 8 m3/h mais < à 80 m3/h |
D |
||||
|
|
Ø Eaux superficielles |
|
|||
|
|
2.2.0 |
Rejet susceptible de modifier le régime des eaux |
§ Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité total de rejet étant : |
||
|
³ à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit |
A |
||||
|
compris entre 2 000 et 10 000 m3/j (ou compris entre 5 et 25 % du débit)
|
D
|
||||
|
|
2.3.0Arrêté 23 02 01 |
Rejet divers |
§ Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 : |
||
|
- Le flux total de pollution brute étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : .Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ; .BO5 : 60 kg/j ; .CO : 120 kg/j ; .Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ; .Azote total (N) : 12 kg/j ; .Phosphore total (P) : 3 kg/j .Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ; .Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ; .Hydrocarbures : 0,5 kg/j ; |
A |
||||
|
- Le flux total de pollution brute étant compris entre les valeurs indiquées ci-après : .Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j .DBO5 : 6 à 60 kg/j ; .DCO : 12 à 120 kg/j ; .Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j ; .Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j .Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ; .Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ; .Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ; .Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ; |
D |
||||
|
§ Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli , par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié : |
|||||
|
Étant supérieur ou égal à 1011 E coli /j |
A |
||||
|
Étant compris entre 1010 et 1011 E coli /j |
D |
||||
|
|
2.4.1 |
Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées |
§ Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées
A |
||
|
|
Ø Mer |
Au sens du présent titre le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 [permil] |
|||
|
|
3.2.0.1 |
Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 |
Le flux total de pollution brute : |
||
|
Étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ; DBO5 : 120 kg/j ; DCO : 240 kg/j ; Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ; Azote total (N) : 24 kg/j ; Phosphore total (P) : 6 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ; Hydrocarbures : 1 kg/j ; Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants : COT : 80 kg/j. |
A |
||||
|
Étant compris entre les valeurs indiquées ci-après : Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j DBO5 : 12 à 120 kg/j ; DCO : 24 à 240 kg/j ; Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ; Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ; Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ; Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j ; Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants : COT : 8 à 80 kg/j |
D |
||||
|
|
3.2.0.2 |
// |
Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines : |
||
|
Étant supérieur ou égal à 1012 E coli /j |
A |
||||
|
Étant compris entre 1011 et 1012 E coli /j |
D |
||||
|
|
Ø Ouvrages d'assainissement |
|
|||
|
|
5.1.0 |
STEP |
§ Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant : |
||
|
Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) (Arrêté du 22 décembre 1994 ) |
A |
||||
|
Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 120 kg de DBO5 (Arrêté du 21 juin 1996) |
D |
||||
|
|
5.2.0 |
Déversoirs d'orage |
§ Déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier : |
||
|
Supérieur ou égal à 120 kg de DBO5 |
A |
||||
|
Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5 |
D |
||||
|
|
5.3.0 |
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles… |
§ Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant : |
||
|
Supérieure ou égale à 20 ha |
A |
||||
|
Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha |
D |
||||
|
|
5.4.0 |
Épandage de boues issues du traitement des eaux usées |
§ Épandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant : |
||
|
Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an ; |
A |
||||
|
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an. |
D |
||||
|
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. |
|||||
|
|
5.5.0 |
Épandage d'effluents ou de boues autres que ceux visés à la rub 5.4.0 |
§ Épandage d'effluents ou de boues, à l'exception ce celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant : |
||
|
Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DB05 supérieur à 5 t/an |
A |
||||
|
Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 m3/an et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an. |
D |
||||
|
|
Ø Travaux divers |
|
|||
|
|
6.1.0 |
Travaux prévus à l'article L 211-7 du code de l’environnement |
§ Travaux prévus à l'article L 211-7 du code de l’environnement ( ex article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau) le montant des travaux étant : |
||
|
Supérieur ou égal à 1 900 000 euros |
A |
||||
|
Supérieur ou égal à 160 000 euros, mais inférieur à « 1 900 000 euros |
D |
||||
2.2.4 |
Prescriptions générales applicables aux installations |
|
|||
|
|
L214-3CE |
Fixation des prescriptions |
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires. |
||
|
|
L214-7CE |
Prescriptions applicables aux ICPE |
(cf principe d’une autorisation unique ICPE avec intégration dans les prescriptions de fonctionnement des dispositions suivantes) Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V (ICPE) sont soumises aux dispositions des articles : - L. 211-1 : Pp généraux de gestion et de préservation de la ressource en eau - L. 212-1 à L. 212-7 : Respect des SDAGE et SAGE - L. 214-8 : Moyens de prévention et de mesure - L. 216-6 et L. 216-13 : Sanctions Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements (cf item 1) |
||
|
|
L214-8CE |
Moyens de mesure et d’évaluation |
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V. |
||
|
|
Art 13 du décret n°93-742 Du 29 mars 1993 |
Contenu de l’autorisation |
Art. 13 - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. (D. no 94-469 du 3 juin 1994, art. 18) En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret. (D. no 95-40 du 6 janv. 1995, art. 4) En ce qui concerne les opérations mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 232-9 du Code rural, les prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R. 232-1 et R. 232-2 du même code. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. (D. no 2002-89, 16 janv. 2002, art. 55, II) Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. (D. no 2002-89, 16 janv. 2002, art. 55, II) Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. |
||
|
|
Art 31 et 32 du décret n°93-742 Du 29 mars 1993 |
Contenu de la déclaration |
Art 31 - Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l’article L214-2CE (prescriptions générales) ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l'article 32 (arrêtés complémentaires). Art. 32 - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté… ( il convient de se référer pour connaître les prescriptions générales aux arrêtés relatif à telle ou telle opération mentionnée à la nomenclature EAU , Cf item 1.2.3) |
||
|
|
|||||
2.3 |
Eau potable
|
|
|||
|
|
|||||
2.3.1 |
Prélèvement |
|
|||
Ø Tout prélèvement |
|
||||
|
|
Art 131 et Art 132 du code minier |
Pp de déclaration à la DRIRE |
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. |
||
|
|
|
Soumission des prélèvements à la nomenclature Eau |
Tous les prélèvements ou les opérations y conduisant sont soumis à la procédure décrite à la section ci-dessus, dès lors qu'ils ne sont pas assimilés aux usages domestiques et qu'ils ne sont pas nécessaires à une installation classée et relèvent donc de la nomenclature « Eau ». Celle-ci distingue les opérations dans les nappes d'eau souterraines les soumettant généralement à autorisation dès lors que le prélèvement est supérieur ou égal à 80 m3/h ou à déclaration s'il est supérieur à 8 m3/h mais inférieur à 80 m3/h (rubrique 1.1.0) de la nappe. Si le prélèvement et les installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, sont effectués dans la nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, la procédure applicable dépend de la proportion du débit total de prélèvement par rapport au débit moyen mensuel sec de récurrence de cinq ans du cours d'eau (rubrique 2.1.0). |
||
|
|
L215-13CE |
DUP pour la prise d’eau dans un but d’intérêt général |
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. |
||
|
|
Ø Prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine- procédure |
[ Schéma de la procédure de mise en place des périmètres de protection des captages] |
|||
|
|
Art 1 du décret du 20 décembre 2001 |
Définition d’eau destinée à la consommation humaine |
1o Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ; 2o Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique. Ne sont pas concernées les eaux minérales naturelles et les eaux relevant de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (cf Eaux considérées comme produits diététiques assimilables à des médicaments). |
||
|
|
L1321-2 Code de la santé publique et art 5-1 du décret du 20 décembre 2001 |
DUP, autorisation et périmètres de protection |
L1321-2CE :En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. Sur les périmètres de protection voir l’[ article 9 du décret du 20 décembre 2001] Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. Art 5-1 décret du 20 décembre 2001 : L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 7, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, détermine les périmètres de protection à mettre en place. N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille. |
||
|
|
Art 5-2 du décret du 20 décembre 2001 |
Contenu du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau pour la consommation humaine |
Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir : 1o Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article 25 ; 2o L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ; 3o Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologies du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ; 4o L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sur la définition des périmètres de protection ; 5o L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en œuvre ; 6o L'indication des mesures répondant à l'objectif défini au I de l'article 30 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article 36, du cuivre et du nickel ; 7o Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau. Voir pour la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser l’[arrêté du 26 juillet 2002] |
||
|
|
Art 6-III |
Cas des prélèvements non soumis à l’article L214-1CE et qui sont destinées à la consommation humaine |
Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code, seules s'appliquent les dispositions de l'article 5 |
||
|
|
Art 6-I |
Cas des prélèvements soumis à autorisation au titre de l’article L214-1 et qui sont destinées à la consommation humaine |
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 susvisé vaut autorisation au titre de l'article 5. Dans ce cas : a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé est complété conformément aux dispositions du II de l'article 5 et, dans les cas mentionnés à l'article 7, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; b) L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 susvisé, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 5. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code. |
||
|
|
Art 6-II |
Cas des prélèvements soumis à déclaration au titre de l’article L214-1 et qui sont destinées à la consommation humaine |
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du même code et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 5 tient lieu de cette déclaration. Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé. En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article 7 pendant plus de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus à l'article 7, pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
||
2.3.2 |
Qualité et surveillance des eaux destinées à la consommation humaine |
[La gestion des situations de non-conformité en matière d’eau potable] [Décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine – sans les annexes] [Annexe du décret du 20 décembre 2001] |
|||
Ø Paramètres de qualité |
|
||||
|
|
Art 4 |
Jusqu’au 24 décembre 2003 |
Jusqu’au 24 décembre 2003 : paramètre définis dans [le décret du 3 janvier 1989] (possibilité de prolonger la référence à ces paramètres en lieu et place de ceux définis dans le décret du 20 décembre 2001 cf art 51)) |
||
|
|
// |
A compter du 25 décembre 2003 |
Respect des paramètres définis dans le décret du 20 décembre 2001 à l’exception des paramètres suivants : - le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ; - les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ; - la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008. |
||
|
|
Art 2 I |
Limites de qualité |
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; - et être conformes aux limites de qualité définies à [l'annexe I-1] du présent décret. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 |
||
|
|
Art 24 |
Dérogations aux limites de qualité |
Possibilités de faire une demande de dérogation aux limites de qualité définies au point B de [l'annexe I-1] (paramètres chimiques). |
||
|
|
Art 2 II |
Références de qualité destinée au suivi des installations de production et de distribution |
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à [l'annexe I-2] du présent décret |
||
|
|
Art 2 III |
Non accroissement de la pollution des eaux brutes « sources » |
Les mesures prises pour mettre en œuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement : - une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ; - un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine |
||
|
|
Art 3 a) |
Points de conformité aux limites de qualité |
Les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants : a) Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux [annexes I-1 et I-2] |
||
Ø Contrôle sanitaire et surveillance |
|||||
|
|
Art 11 à 17 |
Vérification de la qualité des eaux |
- Programme d’analyse d’échantillon (renvoi à l’annexe II ) ( art 11) - Possibilité pour le préfet de modifier ce programme d’analyse dans les conditions fixées à l’annexe II-3 (art 12) - Possibilité pour le préfet d’imposer des analyses complémentaires (art 13) - Agents de la DASS compétents pour effectuer les prélèvements (art 14) - Les conditions d’échantillonnage pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel ainsi que les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant au tableau I-2.2 de l'annexe I-2 et les méthodes utilisées pour ce calcul sont fixées dans un [arrêté] . - Analyse de ces échantillons par un laboratoire agréé (art 16)
|
||
|
|
Art 18 |
Auto surveillance |
I/ Principe d’auto surveillance continue, par la personne publique ou privée responsable de la distribution, de la qualité des eaux II/ Possibilité de substituer, sous certaines conditions les analyses réaliser conformément au I ci-dessus à celles prévues à l’art 11. III/ Obligations pour la personne responsable de la distribution de tenir à la dispositions du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux. Obligation chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, d’adresser au préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante. |
||
|
|
|||||
|
|
Ø Mesures correctives, restrictions d’utilisation, |
|
|||
|
|
Art 19 |
Information, enquête à effectuer en cas de dépassement des limites de qualité |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31( cas de risques non dus aux installations de distribution), si les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées.. , la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue : - D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ; - D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ; - De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1o du présent article. |
||
|
|
Art 20 et 21 |
Mesures correctives en cas de dépassement des limites de qualité |
Art. 20 - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. Art. 21 - Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. |
||
|
|
Art 22 |
Restriction ou suspension de la distribution de l’eau en cas de risque pour la santé |
Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. |
||
|
|
Art 23 |
Information des consommateurs |
Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles 20, 21 et 22, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article 22, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires. |
||
Eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine |
|
||||
|
|
Art 25 |
Eaux concernées |
Les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public. |
||
|
|
Art 26 I |
Traitements des eaux |
Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées , en fonction des critères définis à [ l'annexe I-3], en : - groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ; - groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ; - groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection. |
||
|
|
// |
Caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux |
Les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement sont fixées par l’arrété d’autorisation (cf art 5). Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées à l'annexe I-3 |
||
|
|
Art 26 II |
Echantillonnages |
Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par [l’annexe I-3], lorsque sont respectées les règles suivantes : 1o Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ; 2o Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ; 3o Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas : a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ; b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ; c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent. Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées à l'annexe I-3 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles. |
||
|
|
Dérogations |
||||
|
|
|||||
2.3.4 |
Installations de production et de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine |
|
|||
|
|
Art 29 |
Installations concernées |
Outre les installations de production les installations comprennent : - 1-Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;… - 3- . l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ; . les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire. |
||
|
|
Art 30 I |
Précautions pour éviter l’altération de l’eau après sa fourniture |
Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au a de l'article 3, des limites de qualité fixées à l'annexe I-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Toutefois, cette obligation s'impose, quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants. (Obligations d’adapter le traitement aux possibilités d’altération dues au réseau intérieur d’un de ces établissements ?) |
||
|
|
Art 30 II |
Preuve de l’imputabilité au réseau intérieur de l’altération de l’eau |
Lorsque les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ne sont pas respectées au point de conformité cité au a de l'article 3, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit. |
||
|
|
Art 30 III et Art 31 |
Obligations pesant sur le responsable du réseau privé |
Art 30 III : Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article 33 Art 31 : Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au a de l'article 3 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que : - les propriétaires des installations mentionnées au 3o de l'article 29 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ; - les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre. |
||
|
|
Art 32 |
Matériaux utilisés dans le système de production et de distribution |
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par l’[arrêté du 29 mai 1997]. |
||
|
|
// |
Produits de traitement utilisé lors de la préparation des eaux |
Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique. L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction. Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet. A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection. |
||
|
|
Art 33 |
Conception, réalisation, entretient des installations de distribution |
- Les installations de distribution d'eau définies à l'article 29 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées à l'article 2. - Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. - Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées - Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. - Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru. Voir [arrêtés à venir] pour les modalités techniques d'application des dispositions du présent article, et pour les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, fontaines, sources accessibles au public, citernes et bâches utilisées temporairement. |
||
|
|
Art 34 |
Produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations |
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé. Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par [ arrêté ] des ministres chargés de la santé et de la consommation, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement ou de constituer une source d'insalubrité. |
||
|
|
Art 35 et 36 |
Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution |
Art. 35 - La mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite. Art. 36 - La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau au point de mise en distribution avant le 22 décembre 2002. Elle indique au préfet les mesures prévues en application de l'article 5 pour réduire le risque de dissolution des métaux. Un [arrêté du 4 novembre 2002] ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb. Voir [Circulaire du 6 décembre 2002] Art. 37 - (V. D. no 95-635, [6 mai 1995, annexe I mod] ) + [Circulaire du 24 octobre 2002] relatif au recensement des branchements publics en plomb [Circulaire du 3 mai 2002] définissant les actions à mettre en œuvre par les DDASS en matière de lutte contre l’intoxication par le plomb. |
||
|
|
Art 38 |
Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics |
Rinçage, nettoyageLes réseaux publics de distribution et les installations non raccordées aux réseaux publics doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité. Réservoirs équipant ces réseaux et installationsIls doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation. |
||
|
|
Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public |
|
|||
|
|
Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d’origine hydrique |
|
|||
|
|
|||||
2.4 |
Assainissement |
|
|||
|
2.4.1 |
Obligation en matière d’assainissement , et de « raccordement »
|
|
|||
|
2.4.1.1 |
¨ Obligation en matière d’assainissement
|
|
|||
|
|
Ø Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif |
|
|||
|
|
L2224-8CGCT |
Prise en charge financière par les communes |
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. |
||
|
|
L2224-12CGCT |
Redevance |
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. |
||
|
|
[ L2224-10CGCTR2224-7 à R22224-10 + art L123- 1,R123-6 R123-9 et R123-14Curb (PLU) ] |
Délimitation zone d’assainissement collectif et non-collectif(Planification) |
(voir PLU art L123- 1,R123-6 R123-9 et R123-14Curb) |
||
|
|
R2224-22 |
Systèmes d'assainissement non collectif |
Les
systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de
la qualité des eaux superficielles et souterraines. |
||
|
|
R2224-8 CGCT, R2224-9 CGCT |
Enquête Pub |
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme. Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. |
||
|
|
Ø Zones sensibles |
|
|||
|
|
Art 6 Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes. + |
Zones sensibles |
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement, pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces zones. En métropole, dans chaque bassin ou groupement de bassins mentionnés à l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, le comité de bassin élabore un projet de carte des zones sensibles. Le comité de bassin transmet le projet de carte aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et régionaux concernés. Le préfet coordonnateur de bassin adresse le projet, avec ses remarques, au ministre chargé de l'Environnement. Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le ministre chargé de l'Environnement. Les cartes des zones sensibles sont actualisées au moins tous les quatre ans, dans les conditions prévues pour leur élaboration. (Art. 7) |
||
|
|
Ø Prestations relatives à la collecte |
|
|||
|
|
R2224-11 CGCT |
Echéancier |
Les communes doivent être équipées d'un système de collecte , pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre d’une agglomération produisant une charge brute de pollution organique: - Supérieure à 900 kg par jour : avant le 31 décembre 2000. - comprise entre 120 kg par jour et 900 kg : avant le 31 décembre 2005 - supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible : avant le 31 décembre 1998.
|
||
|
|
Ø Prestations relatives au traitement |
|
|||
|
|
Echéancier, dérogations |
Les eaux
entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des
situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un
traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement
équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
Même en
cas de dérogation le nouveau délai ne pourra dépasser le 31/12/2005. (R2224-15CGCT dérogations négatives pour zone sensible, voir supra) |
|||
|
|
Ø Objectifs de réduction des flux de substances polluantes |
|
|||
|
|
Document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes |
|
|||
|
|
Ø Programmation de l'assainissement |
|
|||
|
|
Programme d’assainissement |
|
|||
|
|
Ø Interdiction de certains rejets |
|
|||
|
|
Art 22 Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes. |
|
Sous réserve des mesures prises en application de l'article L. 35-8 du Code de la santé publique, il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; b) Des déchets solides, y compris après broyage ; c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; d) Des eaux de vidange des bassins de natation. Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l'alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent. |
||
|
|
R2224-21CGCT |
Boues d’épuration |
Les rejets de boues
d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont
interdits. |
||
2.4.1.2 |
¨ Obligation en matière de « raccordement » ( code de l’urbanisme, code de la santé publique) |
|
|||
|
|
Raccordement |
|
|||
|
|
Raccordement, incorporation, branchement |
|
|||
|
|
Obligations particulière de raccordement d’effluents normalement « interdits » |
|
|||
|
|
Obligation de desservir |
|
|||
|
|
R111-9Curb |
Lotissement |
Art. * * R. 111-8 .- L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. (V C Construction Art L111-5 ; Code santé pub L1331-1 et suivants) Art. * * R. 111-9 .- Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations. |
||
|
|
Usage non domestique |
|
|||
|
|
L1331-10CSP |
Déversements d’eaux usées autre que domestique |
Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. |
||
|
|
L1331-15CSP |
Dispositif de traitement des effluents autres que domestiques |
Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. |
||
|
|
PLU ( cf art L2224-10CGCT) |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
Participation financière pour voies et réseaux nouveaux |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
Soumission du droit d’occuper le sol à la réalisation de certains équipements |
|
|||
|
|
L332-15Curb |
|
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, exige, en tant que de besoin la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (eau assainissement) |
||
|
|
L421-5Curb |
|
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés |
||
|
|
Camping, |
|
|||
|
|
R111-13CUrb |
|
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. |
||
|
|
|
|
|||
|
2.4.2 |
Prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et de traitement
|
|
|||
|
|
|||||
2.4.2.1 |
Ø Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées soumis à autorisation |
|
|||
|
|
Art. 1
|
Définitions, champ d’application |
w Ces dispositions concernent les ouvrages recevant un flux polluant journalier > à 120 kg DBO5 / jour (soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau rub 5.1.0 ). Ces dispositions visent le « système d'assainissement », lui-même composé du : - « système de collecte » désigne : Le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement .Il comprend : . déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 - 1o ) . les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau - « système de traitement » désigne : . les ouvrages d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBo5/j, soumis à autorisation) . les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...). w Il concerne également les sous-produits du système d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues ( voir Item 4 sur les déchets ) w Ces dispositions sont applicables aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées. |
||
|
|
// |
Personne responsable de la construction , de l’exploitation |
Responsable de principe : la commune Possibilité de confier ; - la construction à un concessionnaire ou à un mandataire - l’exploitation à un délégataire |
||
|
|
§ Prescriptions générales pour les nouveaux systèmes d'assainissement
|
|
|||
|
|
[ Art 2, Art 3, Art 4 ] |
Contenu de la demande d’autorisation |
wIl s’agit de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, cette dernière devant contenir entre autre : - L'analyse de l'état initial du site de la station et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de leurs usages - Une présentation de l'état du système d'assainissement existant et de ses extensions … - La nature et le volume des effluents collectés tenant compte des variations saisonnières ; la composition et le débit des principaux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité et leurs variations prévisibles … - Le débit et les charges de référence retenus pour le dimensionnement des ouvrages, tenant compte des variations saisonnières … - Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de matières polluantes véhiculés par le système de collecte au-delà du débit de référence de celui-ci… - L'évaluation des impacts immédiats et différés du projet sur le milieu naturel… - La cohérence du système de collecte et des installations de traitement… - Les possibilités d'élimination et de valorisation des sous-produits… - Les dispositions de conception ou d'exploitation envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs, de bruits aériens ou de vibrations mécaniques … |
||
|
|
Art. 5
|
Sous-produits |
w L’arrêté d’autorisation précise la (les) filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues (valorisation agricole, incinération, CET, ...) + les graisses et les refus de dégrillage. w A tout moment, l’exploitant doit être en mesure de justifier la quantité, la qualité et la destination des boues produites. |
||
|
|
Art. 7
|
PP de réduction de la quantité totale de produits polluants |
w Le système d’assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées par le système, dans tous les modes de fonctionnement (ainsi l’exploitant peut admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes > à ceux de référence).
|
||
|
|
Art 9 |
Fiabilité du système d’assainissement |
w L’exploitant tient à jour un registre qui mentionne les incidents et défauts des matériels recensés et les mesures prises pour y remédier + les procédures à observer par le personnel d’entretien. Cela permet de pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour assurer le niveau de fiabilité des systèmes d’assainissement. w Des performances acceptables doivent être garanties en période d’entretien et de réparations prévisibles.
|
||
|
|
Art 10 |
Entretien et réparation prévisible |
wEn outre, des performances acceptables doivent être garanties en période d'entretien et de réparations prévisibles (art 9) w L’exploitant précise à la police de l’eau pendant la période d’entretien ou de réparations : les caractéristiques des déversements (flux, charge) + les mesures prises pour en réduire l’impact sur le milieu récepteur. La police de l’eau peut demander le report de ces opérations avant leur début. |
||
|
|
Art 11 |
Modifications ultérieures |
La commune (et non l’exploitant ?) informe préalablement le préfet de toute modification des données initiales mentionnées dans le document visé aux articles 2 et 3, notamment la nature des effluents traités, en particulier non domestiques. |
||
|
|
§ Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux systèmes de traitement |
|
|||
|
|
Art 13 |
Fiabilité des installations |
w Avant sa mise en service, le système de traitement doit faire l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. |
||
|
|
// |
Formation du personnel |
w Le personnel doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement de la station.
|
||
|
|
Art 14 |
Points de rejet |
w Le point de rejet est déterminé de sorte à réduire au maximum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment au niveau des captages d’eau potable, des zones de baignade, des zones piscicoles et conchylicoles.
w Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond et des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
|
||
|
|
Art 15 |
Ouvrages de surverse |
w Les ouvrages de surverse éventuelle sont munis de dispositifs permettant d’empêcher tout rejet d’objets flottants dans des conditions habituelles d’exploitation |
||
|
|
Art 16 |
Echantillons représentatifs |
w Les ouvrages doivent être aménagés de sorte à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des différents effluents reçus ou rejetés.
|
||
|
|
Art 17 à Art 19 |
Implantation, préservation du site |
w Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté |
||
|
|
§ Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux tronçons du système de collecte |
Par « nouveau tronçon », on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte ; toute incorporation d'ouvrages existants au système de collecte. |
|||
|
|
Art 20 |
Conception, réalisation, déversoirs d’orage |
w Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les fuites et l’intrusion d’eaux claires parasites... Les déversoirs d'orage sont aménagés pour éviter les érosions du milieu au point de rejet. Aucun déversement ne peut être admis en dessous de leur débit de référence. |
||
|
|
Art 22 à Art 24 |
Raccordements |
wLes réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées wLe service chargé de la police de l'eau peut demander des informations sur les opérations de contrôle des branchements particuliers prévu à l'article L. 35-1 du Code de la santé publique. |
||
|
|
Annexe I |
Réception des nouveaux tronçons |
Les essais, pour la réception de nouveaux tronçons sont consignés dans un procès-verbal mentionnant les repères des tronçons testés avec référence au dossier de récolement, l'identification des regards et branchements testés, les protocoles de tests d'étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués. Canalisations : - test visuel ou par caméra sur l'ensemble du tronçon - test d'étanchéité à l'air ou à l'eau (selon le protocole interministériel du 16 mars 1984) sur l'ensemble du tronçon, après remblaiement complet de la fouille Branchements et regards : - test visuel de conformité - test d'étanchéité à l'air ou à l'eau. |
||
|
|
§ Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement existants |
Sont immédiatement applicables les articles 9 à 11 |
|||
|
|
Art 29 |
Echéancier |
w Le préfet fixe par arrêté complémentaire les conditions et l'échéancier selon lesquels les dispositions de l'article 33 sont rendues applicables à l'ensemble du système de collecte existant. |
||
§ Obligations de résultat |
|
||||
|
|
Art 30 |
Valeurs de rejet des STEP |
w L’arrêté d’autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant des STEP, fonctionnant dans des conditions normales, au vu du document d’incidence, des objectifs de qualité des milieux récepteurs, des usages à l’aval et de l’arrêté fixant les objectifs de dépollution de l’agglomération. w Ces valeurs peuvent être évolutives. w Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en [ annexe II ] pour les ouvrages visés à l'article 9 du décret no 94-469 du 3 juin 1994 ( art R 2224-12 CGCT ). |
||
|
|
Art 33 |
Système de collecte |
w Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un échéancier de progression du taux de collecte annuel de la DBO5 de l'ensemble du système de collecte. L'arrêté d'autorisation fixe également : - le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu naturel admis sur les déversoirs d'orage ; - le taux minimum de raccordement des usagers individuels. Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau sur ces données. Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions représentatives. w Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour : Au terme de l'échéancier fixé par le préfet, l'objectif du taux de collecte annuel de la DBO5 doit être supérieur à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100. Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau.
|
||
|
2.4.2.2 |
Ø Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées soumis à autorisation |
|
|||
|
|
§ Prescriptions relatives à l’auto surveillance des rejets et des sous-produits |
|
|||
|
|
Art 2 et Art 3 |
Programme d’auto surveillance |
w L’exploitant du système d’assainissement, ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d’auto surveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité. w La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les [annexes I et II] (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). w L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spécifiques, prévoir le remplacement de certains paramètres, soit par le suivi en continu d'un autre paramètre représentatif du polluant, soit par d'autres méthodes.
|
||
|
|
Art 4 |
Conditions dérogatoires si les rejets sont susceptibles de créer un impact particulier sur le milieu récepteur |
En cas de : - périodes particulières où le débit du rejet est supérieur à 25 p. 100 du débit du cours d'eau récepteur ; - usages de l'eau en aval mentionnés à la rubrique 2.3.0 (1o) du décret no 93-743 du 29 mars 1993. L'arrêté d'autorisation peut fixer des contraintes plus sévères que celles figurant en annexes I et II et imposer la surveillance du milieu récepteur à une fréquence déterminée |
||
|
|
Art 5 |
Documents à transmettre |
w Sauf dans le cas où les polluants feraient l'objet de mesures de moindre fréquence, les résultats de la surveillance sont transmis chaque mois par la commune au service chargé de la police de l'eau, et à l'agence de l'eau. Ces documents doivent comporter : - l'ensemble des paramètres visés par l'arrêté d'autorisation et le tableau 1, et en particulier le rendement de l'installation de traitement ; - les dates de prélèvements et de mesures ; - l'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant. w Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l'arrêté d'autorisation, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
|
||
|
|
§ Prescriptions relatives à l’auto surveillance du fonctionnement du système d’assainissement |
|
|||
|
|
Art 6 |
Paramètres justifiant la bonne marche de l’installation |
w L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant sur la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues...). |
||
|
|
// |
Suivi et plan du réseau |
w Le suivi du réseau de canalisations doit être réalisé par tout moyen approprié (par exemple inspection télévisée décennale, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires...). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour. |
||
|
|
// |
Registre, rapport de synthèse |
w Un registre est mis à disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau comportant l'ensemble des informations exigées dans le présent article. Un rapport de synthèse est adressé à la fin de chaque année à ces services. |
||
|
|
§ Dispositions particulières pour les événements exceptionnels |
Ces dispositions sont applicables aux systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et aux cas spécifiés à l'article 4 |
|||
|
|
Art 7 |
Surveillance renforcée en cas d’accident… |
Des dispositions de surveillance renforcées doivent être prises par l'exploitant, lorsque des circonstances particulières ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est ainsi notamment en cas d'accidents ou d'incidents sur la station ou de travaux sur le réseau. |
||
|
|
// |
Estimation du flux rejeté, impact sur le milieu |
L'exploitant doit estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces conditions et évaluer son impact sur le milieu récepteur. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES et l'azote ammoniacal aux points de rejet et l'oxygène dissous dans le milieu récepteur. Cette évaluation fait l'objet de la même exploitation que celle prévue à l'article 5-II (transmission immédiate au préfet) |
||
|
|
§ Organisation du contrôle du système d'assainissement par le service chargé de la police de l'eau |
|
|||
|
|
Art 8 I |
PP du contrôle du syst. de surveillance |
Le service chargé de la police de l'eau vérifie la qualité du dispositif de surveillance mis en place et examine les résultats fournis par l'exploitant ou la commune. |
||
|
|
Art 8 II |
Manuel |
L'exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Il est tenu à disposition du service chargé de la police de l'eau, de l'agence de l'eau, et régulièrement mis à jour.
|
||
|
|
Art 8 III |
Validation des résultats |
Le service chargé de la police de l'eau s'assure par des visites périodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. A cet effet, il peut mandater un organisme indépendant, choisi en accord avec l'exploitant. |
||
|
|
// |
Rapport annuel |
L’exploitant adresse, à la fin de chaque année calendaire, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau un rapport justifiant la qualité et la fiabilité de la surveillance mise en place basé notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l'ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesure analytique et exploitation). |
||
|
|
Art 9 |
Contrôles inopinés |
Le service chargé de la police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres mentionnés dans l'arrêté d'autorisation. Dans ce cas, un double de l'échantillon est remis à l'exploitant. Le coût des analyses est mis à la charge de celui-ci. |
||
2.4.3 |
Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux dispensés d'autorisation (soumises à déclaration) |
§ Arrêté intégralement applicable aux opérations soumises à déclaration relevant des rubriques : - 5.1.0 (2o) : stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant supérieur à 12 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5), mais inférieur à 120 kg de DBO5 ; - 5.2.0 (2o) : déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5 § Les chapitres Ier et III du présent arrêté sont applicables aux ouvrages collectifs de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, dispensés de déclaration ou d'autorisation |
|||
|
|
§ Prescriptions générales applicables à l'ensemble des ouvrages (soumis à déclaration ou non) |
|
|||
|
|
Art 2 |
Conception et implantation |
Les ouvrages d'assainissement doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et du milieu naturel (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Une étude doit être réalisée pour définir les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs et le choix du lieu de rejet.
|
||
|
|
Art 3 |
Protection du milieu naturel |
Les eaux usées ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement approprié de manière à : 1o Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines, des eaux estuariennes et marines ; 2o Assurer le respect des objectifs de qualité assignés aux milieux hydrauliques superficiels et des schémas départementaux de vocation piscicole fixés par le préfet ; 3o Le cas échéant, assurer la compatibilité avec les objectifs de réduction des flux de substances polluantes, définis par le préfet en vertu de l'article 14 du décret du 3 juin 1994 susvisé. |
||
|
|
Art 4 |
Rejet dans les eaux de surface |
Les points de rejet dans les eaux superficielles doivent être localisés pour minimiser l'effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de leurs emplacements doit tenir compte de la proximité de captages d'eau potable, de baignades, de zones piscicoles et conchylicoles. L'ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges et éviter la formation de dépôts. Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau. Au point de rejet, la température de l'effluent épuré doit être inférieure à 30 °C et son pH compris entre 5,5 et 8,5. |
||
|
|
Art 5 |
Rejet dans le sol des effluents traités |
Les effluents sont traités en fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration et à l'épuration. Les dispositifs mis en oeuvre doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et leur évacuation par le sol. |
||
|
|
Art 6 |
Épandage sur le sol de l'effluent traité |
L'épandage ne peut être utilisé que dans les cas où ce procédé ne provoque pas de nuisances portant atteinte au sol, au couvert végétal et aux eaux souterraines et ne crée pas de risques pour la santé publique. L'effluent ne doit pas contenir des substances qui, du fait de leur toxicité ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement ou la santé publique. Le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 8,5. Le stockage éventuel des effluents traités est opéré dans des équipements étanches assurant une réserve suffisante : ces derniers seront protégés afin d'éviter tout risque pour la population. |
||
|
|
Art 7et Art 8 |
Entretien des installations et élimination des boues et des graisses |
Les boues et graisses sont valorisées ou traitées conformément aux réglementations applicables, en particulier : - au régime de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé ; - aux dispositions prescrites par le plan départemental de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité de boues extraites (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et leur destination. |
||
|
|
§ Dispositions techniques complémentaires applicables aux seules opérations soumises à déclaration |
lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, les seuils de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l’eau des autres rubriques de la nomenclature ne doivent en aucun cas être dépassés, sans que soit faite au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et que soit obtenu le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation. |
|||
|
|
Art 10 |
Dimensionnement des ouvrages de traitement |
Le dimensionnement des ouvrages doit faire l'objet d'une étude technique, jointe au dossier de déclaration et permettant de justifier que les capacités projetées des ouvrages sont compatibles avec : - le flux polluant à traiter par temps sec et les caractéristiques des effluents à traiter (domestiques, industriels, etc.) dans la zone d'assainissement collectif desservie, tenant compte des variations saisonnières ; - la part de polluants supplémentaire acheminée par temps de pluie selon l'option retenue par le déclarant ; - le plan et les caractéristiques du réseau de collecte, compte tenu des extensions prévues ; - les apports d'eaux parasites résiduelles. |
||
|
|
Art 11 |
Raccordements |
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage. Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte : - une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en DBO5 ; - les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du Code de la santé publique. |
||
|
|
Art 12 |
Déversoirs d'orage et réseau |
Les déversoirs d'orage éventuels équipant le réseau ou situés sur la station ne doivent pas déverser par temps sec. Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuites et les apports d'eaux claires. Des mesures sont prises pour limiter les flux de polluants rejetés en milieu naturel par temps de pluie : ces mesures sont adaptées à la qualité requise par les usages des eaux réceptrices. |
||
|
|
Art 13 |
Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface |
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique. Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 p. 100 sur la DBO5 et de 50 p. 100 sur les matières en suspension (MES). Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont : - soit un rendement minimal de 60 p. 100 sur la DBO5 ou la demande chimique en oxygène (DCO) ; - soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de DBO5. Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3. |
||
|
|
Art 14 |
Rejet dans le sol des effluents traités |
'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une étude soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et jointe au dossier de déclaration. L'étude doit déterminer : - l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines ; - les dimensions du dispositif de traitement et d'infiltration à mettre en place ; - les protections visant à limiter les risques pour la population. |
||
|
|
Art 15 |
Épandage sur le sol de l'effluent traité |
Le dossier de déclaration fait apparaître : - les caractéristiques hydrogéologiques du sol établies par un expert compétent ; - l'emplacement et la superficie des parcelles où l'effluent est épandu ; - le volume et la fréquence des épandages. |
||
|
|
Art 16 et Art 17 |
Implantation |
Protection contre les nuisances auditives et olfactivesLes ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitants et établissements recevant du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages ou des habitations. Les équipements sont conçus et exploités de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Protection contre les cruesLes stations ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf impossibilité technique. Dans ce dernier cas, la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables doivent être justifiées dans le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
|
||
|
|
Art 18 à Art 22 |
Équipements annexes et préservation du site |
Voie d'accès - Tous les équipements de la station nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d'un accès permettant leur desserte en toute circonstance par les véhicules d'entretien. Clôture des ouvrages - L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture. Protection contre le gel - En fonction du climat du lieu d'implantation, les équipements permettent d'éviter le rejet direct des effluents non traités pendant les périodes de gel non exceptionnelles perturbant le fonctionnement des installations. Les moyens mis en oeuvre pourront être déterminés en liaison avec ceux qui sont évoqués à l'article 24. Bassin d'orage - Les bassins d'orage éventuels doivent être étanches. Leur vidange doit être assurée dans un délai de vingt-quatre heures maximum. Dégrillage - Un dégrillage doit être placé en amont des dispositifs de traitement ou, le cas échéant, de prétraitement. |
||
|
|
Art 23 |
Exploitation ( formation..) |
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation à l'exploitation des stations d'épuration. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être mesurés périodiquement conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Les résultats de ces mesures ainsi que tous les incidents survenus doivent être portés sur un registre et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Les paramètres visés sont au moins les quantités de boues produites, l'énergie consommée, les quantités de réactifs utilisés et les débits traités estimés. |
||
|
|
Art 24 |
Maintenance |
Le dossier de déclaration précise : - l'échéancier et la durée des périodes de maintenance pouvant entraîner l'arrêt partiel ou total des équipements de traitement ; - les moyens prévus pour limiter l'impact des rejets directs dans le milieu récepteur. |
||
|
|
Art 25 |
Contrôle des rejets |
La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir. Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement. |
||
|
|
Art 26 |
Auto surveillance de la station d'épuration |
L'auto surveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante : - flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes DBO5 : 2 fois par an ; - flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes DBO5 : 1 fois par an. Cette auto surveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau. |
||
|
|
|||||